
UB- Préhistoire
Le site de Préhistoire de l'Université de Bourgogne
Cours en ligne
Licence 1 - Préhistoire ancienne
| Les études | Le Prof | Informations scientifiques | Liens | Contact |
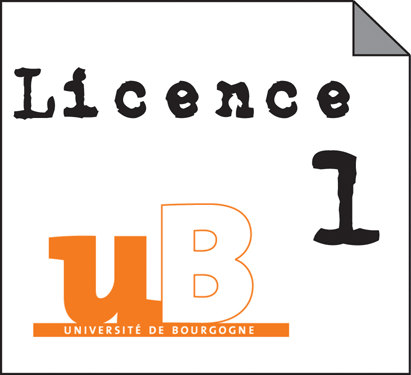
Préhistoire ancienne
Cours 7 : Les cultures du Paléolithique et du Mésolithique – II : Le Paléolithique supérieur
Vers : L'organisation des études en L1 Introduction au Néolithique |
Cours en ligne - Licence 1
|
|
Préhistoire ancienne Cours 7 : Les cultures du Paléolithique et du Mésolithique – II Le Paléolithique supérieur
|
La semaine dernière, nous avons commencé une série de trois cours sur les grandes cultures du Paléolithique et du Mésolithique que nous envisageons essentiellement à partir de ce que nous appelons les industries, c'est-à-dire les outillages.
Nous avons vu les principales cultures et les outils du Paléolithique inférieur et du Paléolithique moyen, nous allons aujourd’hui nous intéresser au Paléolithique supérieur.
Alors, tout de suite, une remarque introductive importante, c’est que ces cultures du Paléolithique supérieur vont être beaucoup plus nombreuses parce que :
- moins longues dans leur durée aussi. Rappelez vous que l’Oldowayen dure probablement 1 MA, entre 2,6-2,5 et 1,5 MA, l’Acheuléen encore plus longtemps entre 1,5 MA et 200000 ans en Afrique et un peu mois longtemps en Europe (700 ou 600000 jusqu’à 250000) puis le Moustérien durent encore de 250000 jusqu’en 40000. Les cultures du Paléolithique supérieur ne dureront que quelques milliers d’années (10000 au plus mais souvent 3 ou 4000 ans) avant que n’apparaissent un nouvel ensemble avec de nouvelles traditions culturelles.
Alors évidemment les raisons de ce brusque changement d’échelle, de cette évolution qui s’accélère, nous échappent encore en grande partie.
Bien sûr, c’est aussi un effet de la recherche, puisque nous avons plus de sites connus pour cette période du Paléolithique supérieur que nous connaissons donc mieux et que nous pouvons subdiviser de ce fait.
Mais pas seulement. Il y a réellement plusieurs ruptures, nettes ou moins tranchées selon les cas, dans l’évolution des cultures entre 40000 et 12000 avant notre ère.
Voyons maintenant quelles sont ces grandes cultures, leur géographie, leur chronologie et leurs principaux outillages et objets, puisque nous reviendrons dur l’habitat, les rites funéraires et l’art lors de cours thématiques très bientôt.
Du fait de cette explosion des cultures matérielles et du temps qui nous est imparti, je ne traiterai ici que de la France essentiellement et un peu moins du reste de l’Europe en laissant de côté les autres continents.
Je vous ai mentionné la semaine dernière les deux premières cultures du Paléolithique supérieur qui sont le Châtelperronien et l’Aurignacien et qui apparaissent autour de 40000 à 37000.
Commençons par évoquer le Châtelperronien qui apparaît vers 37000 parce que cette culture est considérée par l’essentiel de la communauté scientifique comme celle des derniers néandertaliens.
Sachez quand même que pour certains, et parce qu’elle semble très évoluée, elle ne peut-être que le fruit d’hommes modernes.
Les découvertes le plus récentes semblent tendre vers une possible attribution du Châtelperronien aux néandertaliens (et cela jusqu’aux prochaines découvertes).
Le site éponyme est donc la grotte de Châtelperron, du côté de Moulins dans l’Allier. Et elle a été fouillée au milieu du XIXe puis au milieu du XXe siècle.
Géographiquement, cette culture se concentre en France et peut-être dans certaines régions d’Espagne et aura une courte durée puisqu’elle disparaît vers 30000.
Il existe aussi une culture voisine en Italie appelée Uluzzien, un peu plus récente.
Le Châtelperronien qu’il soit ou non le fait des derniers néandertaliens est incontestablement une culture du Paléolithique supérieur.
La principale caractéristique est le développement et la généralisation du débitage laminaire – dont on a vu qu’il est apparu anciennement mais modestement dans certaines cultures – mais ici dans le but essentiel de fabriquer de petites pointes sur support laminaire à emmancher
Mais le développement de ces modes de débitage va aussi entraîner le développement d’une véritable panoplie d’outils qui vont remplacer les « outils à tout faire » du Moustérien : burins, grattoirs, perçoirs…
Une autre caractéristique est le développement de l’outillage sur matière dure animale (os et bois ou ivoire).
Il ne s’agit plus comme dans les périodes antérieures de l’utilisation de l’os comme matériaux pour réaliser des outils indifférenciés, mais d’un véritable outillage spécifique, avec des techniques d’ores et déjà bien maîtrisées pour la mise en forme des objets.
Il s’agit pour l’essentiel de poinçons et de sagaies, parfois de lissoirs pour travailler les peaux mais on va aussi trouver des outils frustes, pelles et pioches et des outils très finement travaillés comme des épingles.
L’objet caractéristique est quand même un outil en silex, c’est la Pointe de Châtelperron qui est une pointe à dos de petites dimensions (40 à 65 mm en moyenne) devant être emmanchée.
Si l’art au sens strict n’est pas encore connu (peintures, gravures), une abondance de parures très diverses est notable.
Diverses à la fois, comme vous pouvez le voir, en matériaux et en morphologies.
L’autre culture majeure de la période est l’Aurignacien.
En réalité cette culture apparaît entre 40000 et 38000, c'est-à-dire probablement avant le Châtelperronien, pour perdurer jusqu’à 26 à 25000.
C’est la culture des premiers hommes modernes en Europe occidentale et c’est elle qui permet de dater l’apparition de ces derniers dans cette région.
En même temps, il est très possible que la culture matérielle des derniers néandertaliens ait évolué, au contact des premiers hommes modernes et de la culture aurignacienne se traduisant par le passage du Moustérien au Châtelperronien.
L’Aurignacien est reconnu dès le XIXe siècle lui aussi (1860) sur le site d’Aurignac en Haute-Garonne. Et cette culture va donc s’étendre en Europe et au Proche Orient peut-être entre 40000 et 38000.
Comme d’habitude, il y a plus de questions que de réponses.
Tout d’abord, si à partir de 30000 on est sûr que l’Aurignacien est attribuable à l’homme moderne, dans la période 40000 – 30000, les rares restes humains mis au jour, de type robuste, pourraient aussi bien être des néandertaliens qui auraient alors partagé la même culture que les hommes modernes.
Ensuite, l’origine de cette culture est aussi discutée, pour certains, ce sont les hommes modernes qui l’apportent depuis le Proche Orient en Europe, pour d’autres elle serait une évolution du Moustérien du Paléolithique moyen. Là encore, rien n’est réellement tranché.
Concernant la culture matérielle, c’est le débitage laminaire qui domine, avec aussi une production de lamelles, c'est-à-dire de petites lames fines qui se développent à ce moment, au début du Paléolithique supérieur.
Les outils sont nombreux et variés avec des lames retouchées, des burins, des grattoirs, des perçoirs et des pointes déclinées en de nombreuses variantes.
L’outillage osseux et très abondant et très variés lui aussi de même que les parures.
La suite du Paléolithique supérieur est toute tracée, parce que tout est déjà présent ou en germe dans l’Aurignacien, y compris l’art que nous reverrons prochainement.
Le suivant de ces grands ensembles culturels est appelé le Gravettien, est une culture qui apparaît en Europe autour de 30000 – 28000 BP selon les chercheurs.
Celui-ci a été caractérisé sur le site de la Gravette, en Dordogne.
On distingue plusieurs outils très caractéristiques du Gravettien parmi lesquels la pointe de la Font Robert et la pointe de la Gravette.
Il semble présent dans la totalité de l’Europe et se divise en grands faciès géographiques et en plusieurs phases chronologiques.
Pour ne parler ici que de l’Europe occidentale, on distingue :
- Un Gravettien ancien à pointes de la Gravette seules, anciennement appelé Périgordien IV.
- Un Gravettien récent entre 24 et 22000 BP, le mieux connu et qui est caractérisé par des pointes de la Gravette et des burins dièdres.
- Un Gravettien final entre 22000 et 21000 BP, anciennement appelé Protomagdalénien qui n’est connu que par 3 sites.
A la fin du Gravettien, nous entrons dans le maximum glaciaire en Europe, cet épisode commence vers 22000 BP pour atteindre son paroxysme vers 18000.
Les industries de la fin du Gravettien témoigneraient d’une diversité imputable à une adaptation à cette péjoration climatique.
Dans cette période, nous allons trouver deux cultures principales :
- et le Badegoulien, autrefois appelé Magdalénien 0.
Tout d’abord il n’y a pas de réelle rupture entre le Gravettien et le Solutréen.
Un phénomène remarquable est le reflux des populations d’Europe vers la Méditerranée à partir de 22000 BP, fuyant le refroidissement glaciaire.
De nouvelles populations s’installent donc dans le Midi et vont se transformer peu à peu :
On distingue :
Le Protosolutréen qui se développe entre 22000 et 21000 BP est marqué par une perduration des traditions gravettiennes en même temps que par l’apparition des éléments qui composeront le Solutréen.
On observe une augmentation des grattoirs et une baisse importante des pièces à dos (les petites armatures).
Le Solutréen a été défini à partir du site de la Roche de Solutré en Saône-et-Loire.
Le Solutréen ancien se place entre 21000 et 20000 BP, il se caractérise par une dominante des grattoirs sur les burins et l’apparition des pointes à face plane (outil proprement solutréen).
A ce moment l’aire de répartition est très réduite à la Péninsule Ibérique et le sud-ouest de la France.
Le Solutréen récent qui lui succède entre 20000 et 19000 BP va avoir une répartition plus large en Europe occidentale, remontant jusqu’au Bassin Parisien et même le bassin de la Saône avec le site éponyme de Solutré.
Mais il n’atteint pas le Rhin, ni même l’Auvergne probablement de trop froides régions.
Ce qui caractérise le Solutréen récent, ce sont les pièces bifaciales à retouche couvrante, les pointes à cran et les pointes à pédoncule et ailerons.
Les objets les plus représentés probablement de la Préhistoire.
Evidemment un outillage complet est toujours présent où les grattoirs dominent les burins des périodes antérieures.
L’outillage en matière dure animale est dominé par les sagaies toujours simples qui existaient dans les phases précédentes du Paléo sup, et l’apparition de l’aiguille à chas.
Vous pouvez voir aussi quelques éléments de parure présents sur la photo de gauche.
Entre 19000 et 18000 BP, la péjoration climatique atteint son maximum et c’est sans doute la cause de lacunes importantes dans les séquences d’occupations des principaux sites de la période.
On parle à cette époque d’un épisolutréen très méconnu, car il y a donc très peu de sites.
Il regroupe en Languedoc, le Salpétrien et un solutréo-gravettien en Espagne…
Après cette lacune entre 19500-19000 et 18500-18000, apparaît le Badegoulien quelque part entre 18500 et 18000 BP.
Le nom vient lui aussi d’une grotte de Dordogne, la grotte de Badegoule.
On est donc là dans une période particulièrement froide.
Le Badegoulien se divise généralement en 2 grandes entités géographiques :
L’industrie ne montre pas de caractères notablement particuliers.
Il y a évidemment aussi une industrie sur os
Il faut faire ici une petite parenthèse car nous avons évoqué la situation en Europe occidentale, qui se limite presque à l’époque à une moitié de la France et à la Péninsule Ibérique.
A cette période, je vous l’ai signalé, se développe à l’Est du Rhône, un complexe que l’on nomme Epigravettien.
Entre 22000 et 17000, dans la période du maximum glaciaire, se développe un Epigravettien ancien qui va caractériser diverses zones refuges de l’Europe méridionale, centrale et orientale.
Ces cultures vont évoluer de façon autonome pendant plusieurs millénaires et sont caractérisées sous tout un tas de noms différents dont je vous fais grâce.
Ces cultures résultent tout autant de leur isolement que de la nécessité à s’adapter à ne environnement que l’on qualifie pudiquement d’hostile.
Après cette phase de maximum glaciaire, l’Europe centrale va être recolonisée par des groupes que l’on qualifie d’Epigravettien récent.
En Europe centrale et orientale comme en Provence, ces ensembles culturels vont perdurer jusque vers 13000-12000 BP.
En revenant à la marge occidentale de l’Europe, la période 17000-12000 BP est appelée Pléniglaciaire récent et va être caractérisée par la culture sans doute la mieux connue du Paléolithique supérieur : Le Magdalénien.
Le Magdalénien a été reconnu dès 1869 sur le site éponyme de la Madeleine dans le Périgord.
Ce Magdalénien va concerner la Péninsule Ibérique, La France, la Suisse, le sud de l’Allemagne et l’Autriche jusqu’en Pologne et en Moravie qui sont atteintes par cette colonisation autour de 15000 BP.
Le Magdalénien est divisé évidemment en plusieurs phases chronologiques dans certaines régions comme la Péninsule Ibérique et le sud-ouest de la France.
Le Magdalénien pourrait apparaître en Péninsule Ibérique où les dates autour de 17000 sont les plus anciennes. Il se diffuserait ensuite vers le nord.
Voici un aspect des industries lithiques qui perdent un peu du niveau de technicité atteint avec le Solutréen, mais demeurent caractéristiques du Paléolithique Supérieur.
C’est surtout l’industrie sur matières dures animales qui connaît alors un développement sans précédent, l’os fournissant une matière première très largement utilisée pour la réalisation d’une très large gamme d’outils.
Evidemment, on connaît aussi des parures nombreuses et largement diversifiées.
Il y a évidemment une séries de phases qui caractérisent l’évolution du Magdalénien dans les diverses régions.
Dans le sud-ouest, on distingue :
- Un Magdalénien moyen entre 15000 et 13500 BP, est marqué par une extension géographique plus large, l’industrie change peu mais l’industrie osseuse se développe et l’art mobilier est très important.
- Un Magdalénien supérieur entre 13500 et 12000 BP. C’est le moment d’une amélioration climatique notable où les sites deviennent beaucoup plus nombreux aussi bien dans la zone de l’Epigravettien que dans celle du Magdalénien. L’industrie lithique demeure monotone avec quelques types particuliers. Les sagaies présentent un ou deux rangs de barbelures.
Chaque région possède en fait ses faciès et ses propres évolutions du Magdalénien qui pourraient faire l’objet d’un cours spécifique annuel sans trop de problèmes.
Lors du prochain cours, nous verrons l’évolution des cultures de l’Epipaléolithique et du Mésolithique.
Mais, ce qui caractérisera le plus les cultures du Paléolithique supérieur, c’est à la fois les habitats, les sépultures et encore plus l’art mobilier et rupestre que nous verrons dans les prochains cours.
Orientation bibliographique :
BAFFIER D., 1999 – Les derniers néandertaliens. Le Châtelperronien. Paris : La maison des roches, 1999, 121 p., (Histoire de la France préhistorique).
DELPORTE H., 1998 – Les Aurignaciens : Paris : La maison des roches, 1998, 126 p., (Histoire de la France préhistorique).
DJINDJIAN F., KOSLOWSKI J., OTTE M., 1999 – Le paléolithique supérieur en Europe, Paris : Armand Colin, 1999, 474 p. (Collection U)
PIEL-DESRUISSEAU J.L., 2002 – Outils préhistoriques. Formes, fabrication, utilisation, Paris : Dunod, 2002, 320 p. (4e édition).
SACCHI D., 2003 – Le Magdalénien, Paris : La maison des roches, 2003, 128 p., (Histoire de la France préhistorique).
Cours au format PDF téléchargeable et imprimable